L’irruption d’une multitude d’acteurs, sous forme de plateformes numériques mettant en relation offreurs et demandeurs dans un nombre grandissant d’activités économiques, est médiatiquement présentée comme une lame de fond, un véritable « tsunami » pour la plupart des secteurs de l’économie traditionnelle. Mais l’assimilation du phénomène à une sorte d’invasion de « barbares » bien décidés à faire sauter les pratiques et les circuits classiques pour installer leur pouvoir à la place des anciennes forteresses, risque de nous faire passer à côté de l’origine de ce phénomène. Il ne s’agit pas uniquement de la fougue conquérante de nouveaux entrants, mais aussi de l’étendue des ouvertures offertes aux acteurs économiques.

S’il s’agissait seulement d’une énième querelle entre anciens et modernes, sans autre différence de fond que l’utilisation de moyens numériques prodigieux, nous n’assisterions pas à un tel engouement, à une telle explosion de la demande pour ces nouveaux venus. Ce qui est frappant, ce ne sont pas leurs prouesses matérielles. Le fait qu’en 2015, BlaBlaCar, champion du covoiturage, ait réussi à « lever » sans grande peine 200 millions d’euros a fasciné la sphère financière, mais le plus significatif est que cette société soit parvenue à fédérer en très peu de temps une « communauté » transnationale dépassant 20 millions de membres fortement motivés, prêts à suivre ou à pousser l’entreprise à aller plus loin.
En fait, la raison majeure de l’émergence même de ces entreprises et la justification de leur succès remarquable est à rechercher dans leur aptitude à réduire un profond déséquilibre qui n’a cessé de s’accroître au cours de l’évolution économique. Ce déséquilibre provient du décalage progressif entre la production et l’échange. Plus précisément, de l’écart grandissant entre, d’une part, les progrès saisissants de la production sous toutes ses formes, et d’autre part, la pauvreté ou même l’absence d’échange réel entre offreurs et demandeurs. De ce point de vue, la « désintermédiation » que permet Internet en mettant en relation directe des offreurs et des demandeurs est loin d’avoir tenu ses promesses : elle ne nourrit aucunement la profondeur de l’échange.
La stimulation de la production a certainement représenté au départ une force remarquable, induisant un déséquilibre moteur. Mais au fil du temps, le déséquilibre entre production et échange génère une multitude de situations de blocage.
Dans ces conditions, le succès des nouveaux entrants, loin de se définir en termes de pouvoir, résulte de leur capacité potentielle à créer les conditions de redécouverte et de reconstruction d’un échange plus vrai, mieux équilibré… L’attraction et l’action de ces entreprises transgressives ouvrent ainsi la perspective d’une réduction de l’écart entre la vigueur captivante de la production et l’atonie de l’échange réel et durable.
Cette perception est encore loin d’être partagée ; et si, grâce à tel ou tel nouvel entrant, l’échange progresse, rien ne garantit sa pérennité et son approfondissement à grande échelle. Mais l’ouverture créée vaut le détour.
Le creusement du décalage entre production et échange
Dans les sociétés anciennes, il semblait acquis que l’économie était à la fois faite de production et d’échange. Les productions lentes et primaires ne générant que peu de surplus, la tendance fut même de privilégier l’échange et le troc dans la naissance des mécanismes économiques. L’échange était chargé d’une forte implication humaine. Il était inconcevable qu’il se fasse sans la rencontre physique des acteurs ; il intégrait nécessairement une négociation, la perception d’avantages partagés. Il pouvait même déborder le cadre des biens échangés et servir l’expression de parades ou de défis (comme la cérémonie du Potlach décrite par Marcel Mauss1)…
Bien qu’au fil du temps les choses aient pris une tout autre tournure, il est frappant de constater que dans nos sociétés actuelles, une sorte de mémoire de ce gène premier se soit maintenue. Interrogé sur le contenu de l’économie, l’homme de la rue associera pêle-mêle, argent, entreprises, État, impôts, produits…, mais citera aussi l’échange ou « les échanges ».
De leur côté, les théoriciens et les « spécialistes » de l’économie ont toujours été gênés par la dimension trop humaine, trop volatile, trop peu modélisable de l’échange. Ils ont donc plutôt mis en avant la production et l’allocation rationnelle (voire optimale) des ressources rares et limitées face aux besoins et désirs illimités des groupes humains…
Après tout, si l’écrasante majorité des sociétés humaines a été historiquement marquée par le manque, il semble à la fois logique et rassurant de privilégier la production, en tant que moyen majeur de lutte contre la rareté. D’ailleurs, pour entrer dans l’échange, encore faut-il avoir quelque chose à échanger… Si tel n’est pas le cas, alors va pour la production !
La production, c’est la création et l’agrégation des valeurs ajoutées générées par les acteurs économiques. C’est donc la base du revenu et l’élément principal de la « richesse des nations ». Son expansion est la source de la croissance du revenu par tête, du développement, du progrès… Les arguments sont nombreux pour en faire la priorité économique.
Ce faisant, qu’en est-il de l’échange ? Au cours de l’évolution, il a certes suivi l’expansion de la production, mais en restant cantonné à la sphère quantitative. Lorsqu’on évoque le « développement prodigieux des échanges mondiaux », il s’agit du nombre de tonnes, de barils, ou des flux monétaires… Plutôt qu’« échangés », il vaudrait mieux parler des quantités circulant d’un point à un autre. L’échange qualitatif ? Il brille par sa rareté ou son absence dans la réflexion comme dans les pratiques économiques.
Sur quel fondement la (re)découverte de l’échange réel pourrait-elle donc avoir lieu ? Les déboires et les succès issus de la focalisation sur la primauté de la production offrent un tableau déroutant des sociétés industrielles, ces dernières ne parvenant pas à donner un contenu convaincant au stade « post-industriel » qu’elles seraient censées avoir maintenant atteint.
Côté déboires, la confusion entre production et reproduction, entre création et duplication, entre abondance et surabondance…, a brouillé nombre d’analyses et de discours, tout en réduisant notablement la motivation au travail des acteurs productifs.
Finalement, dans la quasi-totalité du monde, le maintien cumulé et imprévu des manques les plus primaires (la faim, le manque de logement…) et de surabondances de toute nature (agricoles, industrielles, informationnelles…) a sonné le glas du triomphe annoncé et attendu dans la lutte contre la rareté, au cours du développement économique.
Côté succès, la production sécurisante (à l’allemande) ou fascinante (Japon, Silicon Valley…) de biens et services qui améliorent les performances humaines et permettent de réparer les dégâts du monde industriel premier, est une réalité vécue et répandue. La production de biens matériels gagne en quantité, mais aussi en qualité pour une part d’entre eux. L’exemple de la Chine est de ce point de vue édifiant.
La production de services marchands a également explosé quantitativement, tout en restant plus mitigée sur le plan de la qualité perçue par les acteurs. La croissance de la qualité des services de restauration, de transport ou financiers est loin de faire l’unanimité ; en revanche la qualité de certains acteurs inattendus, l’Inde par exemple dans les services informatiques, est incontestable.
Mais au bout du compte, et malgré ses déboires, la production continue à afficher un développement remarquable. Ce développement est non seulement reconnu par la majorité des acteurs, mais il continue d’irriguer toutes les parties du monde et de faire en sorte que la production fascinante garde tout son pouvoir. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’attraction que suscite dans le monde entier, et pas seulement chez les riches, l’annonce de la sortie prochaine d’un dernier modèle de smartphone, de la mise au point de robots humanoïdes, d’objets « connectés » ou d’automobiles « autonomes ».

Des acteurs comme Elon Musk, le patron de Tesla, sont à la fois des figures emblématiques du dynamitage de l’ancien monde, en même temps que de fantastiques promoteurs de la production fascinante, excédant largement toutes les limites du monde connu (Hyperloop, colonisation de Mars, « bio-défense », etc.).
Sur le fond, on peut douter de l’attirance des leaders de la production fascinante pour l’échange réel. La majorité d’entre eux n’est tentée d’entrer dans l’échange que comme faire-valoir, comme moyen de montrer l’écart ou la supériorité qui les différencie des autres… D’où des parenthèses d’échange, vite refermées.
De son côté, la production sécurisante n’est pas en reste. Elle progresse dans la fiabilité des biens matériels durables comme dans la qualité des matériaux utilisés. Elle avance et innove autant dans les domaines classiques des processus de production, que dans des domaines neufs et sensibles, comme celui de la sécurité numérique.
Et comme si tout cela n’était pas suffisant, l’ambiance productive parvient aussi à installer une fascination permanente, non plus par des sauts technologiques futuristes ou une sécurisation hors du commun, mais par l’image du Grand, à l’opposé de la petitesse humaine. Ce sont alors les chantiers pharaoniques de construction et de rénovation, la hauteur des tours et le gigantisme des ouvrages d’art, qui exercent et stimulent une fascination devenue quasiment « banale » et quotidienne.
Cette quête du « Grand » concerne aussi les mastodontes qui se forment dans la quasi-totalité des secteurs économiques. La fascination se double fréquemment d’un sentiment de peur devant leur puissance affichée, qui impose le respect, la soumission ou la résignation. Et il n’y a pas que les mastodontes mondiaux; les mastodontes régionaux sont aussi dans le même schéma. Un exemple parmi des milliers d’autres: la distribution automobile est « régionale », mais les concentrations réduisent les acteurs à un très petit nombre d’unités multimarques, dont les responsables vous expliquent qu’ils n’avaient pas le choix de faire autrement: c’était manger, ou être mangés!
Tous ces facteurs mis bout à bout ne sont pas faits pour améliorer le domaine de l’échange. De fait, pendant que la production a continué d’envahir le temps et les têtes, l’échange vrai, l’échange qualitatif, a stagné ou régressé… Les pratiques des entreprises détenant les clés de la production des biens autant que des services ont souvent dérivé vers le mépris ou l’ignorance de leurs partenaires, et somme toute, vers un « oubli » de la profondeur et de la nécessité de l’échange pour toute pérennité économique.
Patrick Drahi, fougueux et nouveau capitaine d’industrie dans le paysage des télécoms et des médias, devenu patron de « Libération » et de « l’Express », s’adresse ainsi à ceux qui dirigent ces médias : « Nous n’avons pas vocation à nous parler. Votre job, c’est de faire les meilleurs papiers, les meilleures enquêtes, pour attirer les lecteurs »… Priorité donc à la production, à ce que chacun sait le mieux produire ; chacun son métier et les vaches (grasses) seront bien gardées… Inutile de se rencontrer, de se parler, de se connaître, l’échange ne serait que perte de temps, et d’argent.
Au cours de l’évolution, les rapports entre producteurs, distributeurs et consommateurs, ont été marqués par des guerres et des procès stériles, ou par des manipulations grossières feignant la prise en considération de l’autre. Bref ! Le prix est davantage devenu un rapport de force ou de dupe, qu’un rapport d’échange, comme on peut encore le désigner dans les manuels classiques ou simplement naïfs.
L’ambiance qui en résulte pour les acteurs est lourde de conséquences. Elle favorise l’installation d’une fatalité des « lois de la jungle », qui seraient constitutives de toute forme économique ; chacun se dépêche de prendre ce qui est à sa portée, pour l’« engranger » dans ses résultats à court terme, tant qu’il en est encore temps… La perte du sens d’une économie durable, au sein de laquelle l’échange vrai a toute sa place, et l’oubli de la signification même de l’économie comme élément structurant des sociétés humaines, est patente.
Le début d’un sursaut face à cette situation « insensée » a tardé à se manifester. Mais, à cause des excès des organisations productives, du cynisme des rapports de force, et peut-être aussi grâce à ce « gène » de l’échange qui subsiste encore dans la mémoire collective, un mouvement tenace de redécouverte et de pratique de l’échange réel continue de résister et d’attirer de l’énergie – sans que l’on puisse cependant se prononcer sur son avenir à grande échelle. Ce dernier dépendra d’abord de la prise de conscience de ce qui se joue en profondeur, puis de la capacité des acteurs à en faire une réalité fertile dans les actes et les situations courantes du quotidien.
Des éclosions d’échange réel en réaction au décalage
De nombreuses réactions au décalage grandissant entre production et échange ont eu lieu tout au long de l’évolution, mais dans des micro-situations, où le nombre et la spécificité des acteurs ont autorisé la rencontre et la confrontation d’intérêts différents et de visions distinctes.
Ainsi en a-t-il été de tous les liens directs établis entre producteurs et consommateurs, particulièrement pour les biens agricoles et artisanaux, chaque fois que l’absence de concurrence « loyale » ou que la prégnance des rapports de force devenaient insupportables. L’irruption de l’Internet dans la vie quotidienne a aussi représenté une hypothèse engageante de redécouverte et d’approfondissement de l’échange réel, par la suppression des intermédiaires. Mais on s’est vite aperçu que le lien direct était loin d’être une garantie pour cela, et que ce lien devait être minutieusement travaillé pour aboutir à un échange durable et de qualité.
On a aussi pu se rendre compte que, si les intermédiaires étaient parfois une barrière à l’échange (quand ils sont préoccupés de leur seule commission), ils sont au contraire dans d’autres cas tout aussi fréquents, des aides à l’échange vrai par des conseils avisés et le choix des bons interlocuteurs… Las ! La multitude de situations locales et d’ambition limitée n’a jamais produit un phénomène d’ensemble capable de bousculer les tendances lourdes du non-échange.
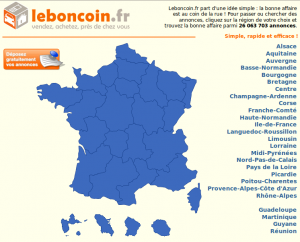
La situation a-t-elle aujourd’hui changé, ou est-elle en passe de le faire ? Les entreprises comme Uber, Airbnb, BlaBlaCar, Drivy, Le Bon Coin…, celles du financement « participatif » (crowdfunding) et la multitude de jeunes pousses innovatrices dans tous les secteurs sont qualifiées de révolutionnaires. Elles sont censées remettre en cause les modèles économiques traditionnels. Qu’en est-il sous l’angle de l’échange ?
Quelle remise en cause des modèles économiques traditionnels ?
Comme nous l’avons exprimé dans la première partie, il n’y a pas sur le fond des modèles économiques traditionnels, mais un seul véritable, fondé sur la maximisation du résultat sous contrainte de coût, par la primauté de la production de biens et de services. L’oubli ou l’éviction de l’échange profond et durable peut être assimilé à une préoccupation intuitive ou raisonnée de réduction des coûts.
Dès lors, le prix est de plus en plus imposé, et si les « cartels » demeurent interdits, ce sont les corporations d’offreurs et les oligopoles qui ont pignon sur rue. L’édification de barrières à l’entrée permet la formation de rentes difficiles à bousculer. Ces corporations et oligopoles se pensent en termes d’institutions, trop grosses ou trop installées pour qu’on puisse s’en passer, et profitent donc de leur pouvoir pour évincer tout échange profond.

Dans ces conditions, Uber et les autres ont d’abord été repérés et sont devenus attirants par un signal « prix ». En affichant des prix plus bas, ils intéressent et « captent » un nombre grandissant de consommateurs. Mais l’histoire économique ne les avait pas attendus pour faire émerger des « casseurs de prix ». C’est donc qu’il y a plus.
Le premier « plus » est, qu’au-delà du prix bas, ils font plutôt émerger la notion de « juste prix ». Le consommateur prend conscience que ce sont bien les mêmes produits ou services qui sont disponibles à un prix plus faible (ce que les casseurs de prix historiques étaient loin de garantir). Donc, à côté de la disposition matérielle du bien, naît aussi un sentiment de justice… qui vaut son prix !
Un second élément différenciateur concerne l’ambiance de la transaction. Le demandeur se retrouve dans la position d’un acteur réel devant l’offreur. Le schéma d’une vraie relation se dessine, et tranche radicalement avec l’état de « numéro » ou de marionnette que l’on occupe face à une corporation ou devant un mastodonte.
De surcroît, en assumant pleinement sa position d’acteur, le demandeur se met en position de devenir lui-même offreur des biens ou des compétences qu’il possède ; consommateur aujourd’hui, producteur demain, et ainsi de suite… On assiste à la naissance d’un acteur entier, potentiellement complet, dans la production comme dans l’échange, et pouvant donc le moment venu, soit louer ses services à une entreprise, soit les faire valoir par lui-même. Aux États-Unis, des statistiques récentes font état d’un actif sur trois agissant en solo ; en Europe, on avance le chiffre de 15 %, mais l’accélération est patente.
Dès lors, se profile un troisième point capital. Uber et les autres se doivent non seulement d’assumer cette sur-dimension du lien économique, mais de la favoriser, et plus encore de l’alimenter. Si pour se déplacer, on choisit Uber ou BlaBlaCar, il est tentant d’attendre de ce choix davantage qu’un simple mouvement d’un point à un autre. On se trouve placé devant une opportunité : celle de vivre un moment d’échange vrai, en tout cas beaucoup plus vrai que dans le cas des prestations classiques, trop instituées, trop codifiées, sans surprises… Si ce n’est un prix plus élevé que prévu à l’arrivée !
Il devient inconvenant de faire des trajets sans décocher une parole, coincé entre deux « geeks » qui ne lâchent pas leur smartphone et encore moins leurs écouteurs… C’est probablement dans l’instauration de conditions et d’attitudes qui n’ont rien des postures conventionnelles de l’offre classique, que se situe la fertilité profonde des nouvelles voies.

D’ailleurs, le choix par un client d’un Uber ou d’un Airbnb suppose, qu’à côté du prix, il existe un a priori de confiance envers l’entreprise. Cette attitude du client est un bon point pour initier l’échange, non seulement avec l’entreprise elle-même, mais aussi avec tous ceux (fournisseurs ou clients) qui partagent le même posultat de confiance.
Ce point de départ est cependant loin d’être suffisant pour assurer la profondeur et la pérennité de l’échange. Pour cela, il faut passer d’un a priori de confiance à la confiance elle-même.
La confiance n’est pas seulement une simple attitude ou un état d’esprit positif. Ici, la confiance devient un bien à part entière. Un bien qu’il faut apprendre à produire et à faire vivre avec une belle capacité de résistance au temps. Dans les exemples cités, il peut ne s’agir que du temps d’un parcours ou d’une location, mais le défi est de poursuivre, continuer, redemander…, tout en faisant progresser le service offert et acheté. Vaste programme d’apprentissage !
C’est en réinvestissant le domaine de l’échange que le phénomène de ces nouvelles pousses, que l’on qualifie un peu trop médiatiquement de « révolutionnaires », le deviendraient vraiment. Si Uber et les autres ne sont finalement que des vecteurs de partage réduisant les coûts et les frais, il n’y aura rien de vraiment nouveau sous le soleil. Les lois classiques de la transformation des trublions initiaux en dictateurs ayant réussi, se manifesteront immanquablement.
C’est aussi en ce sens qu’il faut rester très prudent face aux expressions à la mode et aux vocables racoleurs tels que l’« économie du partage » ou l’« économie collaborative ». L’économie du partage peut simplement se limiter à l’aspect matériel des transactions ; or si cette économie doit marquer un progrès, nous avons insisté sur l’exigence d’un dépassement impératif du seul aspect matériel.
Quant à l’économie « collaborative », des précisions s’imposent sur la signification et la position des « collaborateurs ». Dans l’entreprise, on a souvent utilisé le terme de collaborateur pour masquer la prégnance des rapports hiérarchiques ; on ne faisait que remplacer le terme de « subordonné » par celui de collaborateur, mais le pouvoir des ordres restait le même, parfois pire… D’un autre point de vue, s’il est bon de collaborer, la question devient : mais de collaborer à quoi ? A-t-on un but commun, une ambition commune qui dépasserait le strict calcul matériel, ou le confort de s’assembler avec ceux qui paraissent nous ressembler ?
Les liens entre la collaboration et les acteurs dominants, l’émergence de « collaborateurs » réunis davantage contre un ennemi commun que pour un projet audacieux, ont, on le sait, un goût historique amer… La prudence s’impose !
C’est pourquoi nous préférons largement à ces termes à la mode, celui d’« économie de la relation »2, qui donne tout son sens à la jonction entre production et échange, ne passe pas sous silence le fait que la relation peut-être positive ou négative, et oblige de ce fait à un travail profond, si l’on veut faire en sorte que la relation positive parvienne à surcompenser les ressorts de la relation négative.
Uber et les autres ont, à leur stade de développement actuel, tous les moyens de s’engager avec l’énergie qu’on leur connaît sur cette voie, qui est la seule à mériter le qualificatif de « révolutionnaire ». Encore faut-il qu’ils en aient la conscience et l’envie. Car les pièges sont multiples, et l’attraction rampante ou manifeste du modèle classique ne faiblit pas.
Les pièges et les fausses pistes
L’échange induit par le mirage technologique et numérique
Le premier piège est celui des mirages technologiques. Couvrir le monde en un clic, trouver l’algorithme qui génère la richesse facile, trouver la molécule qui change la vie, quand ce n’est pas celle du bonheur ou de l’immortalité… Les start-ups ne sont pas toutes concernées par l’importance de l’échange réel, et nombre d’entre elles continuent de donner priorité absolue à leur production innovante, pensant que l’échange en sera fatalement induit. Selon elles, une invention révolutionnaire ne peut que donner lieu à échange. Mais de quel échange s’agit-il ? Celui que nous vivons avec Apple, dans une avidité soumise, surtout depuis l’invention de l’iPhone ?
Un autre piège est celui qui nous ferait confondre l’« ubérisation » en tant que révolution par l’échange réel, et l’utilisation du « big data » numérique, fournissant aux meilleurs prix et délais des biens et services d’un bout à l’autre de la planète.
Du côté des biens, toutes les conditions que nous avons rappelées concernant la signification de l’échange réel ne trouvent pas leur compte. Amazon et autres géants du commerce en ligne n’ont pas de différences profondes avec les modèles économiques classiques. Leur succès tient en ce que l’utilisation impressionnante de la révolution numérique les protège des coûts de structure liés au gigantisme, tout en leur facilitant l’accès aux paradis fiscaux… Mais de progrès déterminants sur l’échange, point.
Du côté des services, le mirage numérique est criant sur la promesse de « services individualisés ». Des services « industrialisés », oui ! Mais sûrement pas individualisés, ni « ultrapersonnalisés », comme en trouve si fréquemment le slogan.
Sur ce plan, les déconvenues sont telles qu’on peut se demander s’il s’agit simplement d’un abus de langage, ou bien de la mise en œuvre de systèmes de manipulation délibérés. Les « services clients » des grands opérateurs téléphoniques atteignent en la matière des niveaux caricaturaux impressionnants…, qui restent cependant assez proches de ceux qui caractérisent les centres d’appels de la majorité des entreprises et des institutions publiques.
Les pratiques de protection et de « récupération »
L’échange réel peut aussi se trouve piégé par la réaction des acteurs existants de la production de biens ou de services, dans leur riposte à la déferlante des nouveaux entrants pour éviter de se faire « ubériser ».
N’ayant manifestement pas assimilé l’intrusion des Uber et autres à une hypothèse de redécouverte de l’échange réel, les responsables des groupes installés tentent de déployer face aux nouveaux « barbares » des actions majoritairement classiques, dont les effets sont loin de remettre en cause leurs principes de fonctionnement.
Parmi ces actions classiques, il faut distinguer, d’un côté, les voies offensives, et de l’autre, une somme de pratiques « douces » d’apparence coopérative.
Les voies offensives
Ce sont les différentes possibilités d’édification de barrières à l’entrée. Les acteurs établis se protègent d’abord en déployant force plaintes et actions judiciaires, éventuellement assorties d’actions « coup de poing »… au propre comme au figuré ! Nous en avons eu des exemples marquants dans les réactions brutales des compagnies de taxis face à Uber, ou des hôteliers et des municipalités face à Airbnb.
Les effets sur l’échange sont évidemment catastrophiques, à la fois dans l’ambiance qui se crée entre offreurs concurrents, mais aussi dans l’échange entre offreurs et demandeurs. On s’éloigne largement des considérations économiques pour basculer dans une vague d’arguments idéologiques, à travers lesquels le client se voit sommé, voire contraint, de choisir son camp.
Un autre type d’action caractéristique vient compléter le tableau : un surcroît de démonstration de force de la part des « poids lourds » du secteur concerné. Au-delà même de leur position acquise, ces derniers se lancent dans des méga-fusions supposées dissuasives, mais davantage guidées par le réflexe que par la réflexion.
Quand elles aboutissent, ces tentatives sont loin d’être toujours couronnées de succès. D’autant que l’effet destructeur de telles fusions sur l’échange réel peut éventuellement se doubler d’une illégalité dans l’abus de position dominante…
Prenant leurs distances avec ces réflexes de force, des pratiques plus « douces » voient aussi le jour. Elles s’efforcent de « récupérer » les entrants menaçants, en les accompagnant.
Les pratiques d’accompagnement
La voie la plus classique est évidemment celle de l’argent. Les acteurs installés cherchent à financer les nouveaux, à les « couver », à y « investir »… Ce faisant, plusieurs aboutissements sont possibles :
- Il arrive que des entrants menaçants finissent par entrer dans le moule, avoir l’obsession de ressembler un jour au tuteur… et éventuellement de prendre sa place. C’est donc la continuation et éventuellement l’accentuation du modèle existant. On ne compte plus le nombre de start-ups qui ont fini par se vendre aux financeurs, prenant ainsi une retraite anticipée, tout en dispersant leurs ressources créatives dans les services R&D des entreprises bien installées.
- Les nouveaux acteurs peuvent parfois s’installer dans l’infantilisation rebelle, laquelle peut se prolonger dans l’espoir de jouer indéfiniment les trublions, dans une éternelle jeunesse en jeans et baskets… Les hackers de génie payés à prix d’or et les riches créateurs de jeux en ligne nous en offrent un exemple.
- Mais les acteurs menaçants peuvent aussi constituer une irrésistible force d’innovation, qui parvient réellement à pénétrer dans l’univers de l’entreprise « couveuse ». Et cette dernière ne doit plus alors seulement investir, elle doit s’« investir » et prendre le risque que ses fondements mêmes soient bouleversés… Pierre Louette, ancien directeur général adjoint d’Orange, ne craignait pas de le dire : « Nous sommes prêts à investir dans des start-ups dont le business model mettrait le nôtre en danger »… Belle intention de prise de risque. Mais en attendant cette hypothétique occurrence, il concluait : « Déléguer à d’autres (les start-up) une partie de nos investissements permet de mutualiser les risques et d’amplifier nos capacités d’action ». Réalisme classique oblige !
L’échange réel et ses exigences
À la différence de la production, l’échange n’exerce que peu ou pas de fascination sur l’être humain. Il n’a pas non plus le pouvoir d’être sécurisant, au sens d’une « fiabilité » prouvée à long terme. Il est donc soumis à des formes de réticence ou de fuite qui en contrarient l’expansion.
Mais il est aussi nécessaire. Nécessaire au fonctionnement et à la notion même de système économique, nécessaire à l’ajustement de la production dans des limites acceptables, et nécessaire aussi pour le développement coordonné des différents acteurs, sous réserve que l’échange soit réel. Et c’est seulement quand on a la certitude de sa profondeur et de sa pérennité, que l’échange peut devenir enthousiasmant et captivant.
Pour qu’on puisse le qualifier de « réel », et pour qu’il contienne les germes d’une continuité, l’échange doit comporter une condition nécessaire : l’existence d’un lien précis, clair et significatif, entre le prix payé et le bien acquis ; un lien entre le prix demandé et le service rendu.
Cette condition pose des questions majeures dans les différentes composantes de la sphère publique et mérite un traitement à part ; c’est pourquoi, dans ce qui suit, nous laisserons volontairement de côté l’intervention des acteurs publics pour nous concentrer sur les pratiques de la sphère privée.
L’existence d’un lien précis entre le prix payé, le bien acquis ou le service rendu
Ce lien basique et primordial étant imperceptible ou volatil, c’est par là que les trouble-fêtes pénètrent dans l’univers économique en assaillant les forteresses. Au fil du temps, le lien entre prix payé et service rendu devient tellement opaque que les Uber, Ryan Air et autres nouveaux acteurs des sphères réelles et financières, n’ont aucun mal à faire percevoir l’avantage matériel immédiat qu’ils procurent. Payer un prix plus transparent et plus « juste », c’est attirant… Et c’est plus sain !
Mais ce n’est pourtant pas suffisant. Du moins, si l’on veut opérer une véritable transformation, faire souffler un vent de rupture et donner ou redonner du sens à nos pratiques économiques.
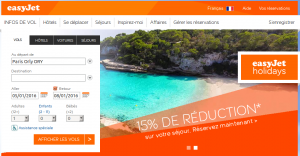
Prenons l’exemple du transport aérien, et examinons le choc opéré par l’entrée de compagnies comme Ryan Air ou Easyjet. Le lien entre le prix payé et le service acquis a été le fer de lance de leur axe concurrentiel ; un prix plus bas et initialement perçu comme plus « juste ».
La recette pour y parvenir est connue : tous les éléments concourant au service livré sont spécifiés, disséqués, analysés, ajustés. La comptabilité « analytique » du service rendu permet un réel progrès en distinguant le nécessaire du superflu, et en pointant du doigt l’énormité de certaines prestations. Parmi les plus caricaturales, celles de pouvoir disposer de journaux ou d’un service de boissons assorties de « sucrés-salés » ont même été au départ un axe de publicité sarcastique pour les nouveaux attaquants…
Oui mais voilà, à force de tout vouloir remettre en cause en passant par la moulinette des coûts, on finit par passer un seuil et basculer alors de l’économie rationnelle et judicieuse à l’avarice pure et simple. Et comme chacun sait, l’avarice n’a jamais été très porteuse d’échange !
Premier couac : la question des bagages ; la logique du coût minimum nous entraîne inexorablement vers le voyageur non seulement « léger », mais idéalement « sans bagage » ! Un théâtre d’un genre nouveau… La chasse aux coûts se traduit par un vrai « flicage » des passagers pour leurs bagages à main : un seul ! Sinon, retour à l’enregistrement ; autant dire, rater l’avion…
Un second exemple, dont l’occurrence plane en permanence, est celui des toilettes payantes dans l’avion. La logique du coût minimum voudrait que l’on y vienne à plus ou moins brève échéance. Ryan Air l’a déjà évoqué le plus sérieusement du monde. Évidemment l’utilisation des toilettes a un coût, que l’on peut précisément calculer. Pourquoi alors ne pas le déduire du billet, et faire payer à la « demande » ? Au bout du compte, voyageur sans bagage, et voyageur sans besoin… C’est l’idéal !
Décidément, l’échange n’a vraiment rien à gagner si l’on s’en tient à la condition première, celle du coût minimum induisant le prix minimum. Le calcul tatillon, dont on ne voit aucunement pourquoi il trouverait des limites, condamne l’échange à l’observation mesquine et au comportement malthusien. Uber lui-même semble s’être laissé aller au-delà du seuil critique ; on sait que des taxis Uber se sont rebellés contre la politique de prix trop bas imposés par la direction et ne permettant pas d’amortir les charges liées aux véhicules acquis et plus largement à l’activité en indépendant pour rejoindre la « communauté » Uber… Un comble !
Enfin, un dernier point tueur d’échange. Quand la recherche et la pratique du prix le plus bas possible tendent à s’imposer comme le seul facteur déterminant, on assiste inexorablement à une chute de la qualité, autant pour les produits que pour les services. Le phénomène existe dans les micro-situations économiques comme dans les flux d’échanges à très grande échelle.
Prenons l’exemple de la grande distribution. Carrefour, et à sa suite tous les acteurs majeurs du secteur, sont entrés dans le jeu économique de la seconde partie du 20e siècle par ce que nous avons appelé plus haut une production fascinante. La production d’un service de commerce censé rendre accessible au plus grand nombre et dans un même lieu, une somme élargie de produits à des prix et avec une disponibilité que le petit commerce était bien incapable d’offrir. Au début, les foules étaient fascinées et allaient à Carrefour comme on va vers un spectacle de découverte et d’envies.
Après avoir éliminé un grand nombre d’acteurs du commerce historique par le biais du prix, les vainqueurs de la grande distribution se sont eux-mêmes livrés à une concurrence sauvage avec pour axe majeur, sinon exclusif, la guerre des prix. Quel en a été le résultat ? Pas de vainqueur incontestable, mais plutôt un affaiblissement progressif de tous les acteurs du secteur au fil des décennies. Dès le début du 21e siècle, les conséquences étaient claires : la réduction des effectifs, et finalement la conjugaison d’une chute de la qualité du service et l’oubli de plus en plus marqué de l’échange avec les consommateurs.
Pour remonter la pente il fallait redevenir plus petit, plus humain, plus proche des clients… Donc ressembler en partie à ceux qu’on avait éliminés…
La prise de conscience de cette réalité est maintenant effective, mais peut-elle infléchir les choses en profondeur ? Écoutons ce que disait le PDG de Carrefour fin 2015, plus de 50 ans après la création de l’enseigne : « La guerre des prix fragilise l’emploi et se termine sur des ruines… Le low-cost s’est beaucoup développé et son bilan est assez discutable… On finit par confondre prix bas et “juste prix”, celui qui rémunère le talent, le travail et l’investissement… Le juste prix prend en compte l’intangible !… qui passe par le goût, l’origine, les procédés de fabrication, l’innovation et les qualités intrinsèques du produit… Carrefour joue naturellement son rôle dans la compétitivité des prix et dans le même temps nous avons choisi d’élargir la communication sur la qualité des produits, en donnant la parole aux clients, en se rapprochant de la production, en favorisant la contractualisation, en valorisant la contribution locale et environnementale… Et cela passe par le travail des équipes… Mettre face aux clients des gens qui connaissent les produits, sauront les faire redécouvrir et apprécier… C’est bien là le sens de notre métier ».
Les occupants des immenses cimetières issus des guerres de la grande distribution se retournent dans leurs tombes… Mais quel admirable plaidoyer final pour l’« intangible » et pour ce qui, dans ce secteur comme dans la plupart des autres, permettrait de remédier à l’oubli de l’échange !
Alors au travail ! Il est impératif de ne pas se laisser enfermer dans une condition de prix minimum qui deviendrait excessive et dictatoriale. Si le lien entre prix payé et service rendu reste une condition première, il faut aller au-delà, en faisant la part belle à l’ambiance humaine, dans la rencontre et l’expression des acteurs.
La création d’une véritable ambiance humaine
L’échange profond et durable ne peut se passer de la création d’une ambiance humaine, dans laquelle la rencontre des acteurs est effective, leur connaissance progressive, leurs moments de négociation loyaux. Facteurs déterminants qui fondent la construction de formes de solidarité, où chacun a le sentiment d’avantages partagés dans la progression du lien à l’autre.
La rencontre des acteurs
Il n’y a pas d’échange vrai sans la rencontre des acteurs représentant chacun des pôles de l’échange. Cette rencontre peut prendre dans un premier temps des formes virtuelles, mais à plus ou moins brève échéance elle doit se faire de façon réelle, aller jusqu’à la rencontre physique – du moins tant que la présence d’êtres humains reste déterminante dans les organisations et aux commandes des machines.
Ce premier point qui devrait aller de soi a été progressivement délaissé, voire fui, au cours de l’évolution économique. Deux types de considérations ont sérieusement entamé la nécessaire évidence de la rencontre des acteurs pour construire l’échange.
D’abord l’emprise du coût minimum. La rencontre est coûteuse en temps, en énergie, et en tout genre de frais liés à la rencontre (déplacement, repas, présents…) ; il est clair que le premier alibi pour éviter la rencontre est celui du coût… Surtout si on argue du fait que la rencontre est probablement inutile, car le bien ou le service à livrer se suffit à lui-même. Les sociétés de consommation ont toujours caressé ce rêve : que l’échange se fasse non pas pour les biens, mais par les biens. Et que l’homme ne soit qu’un intermédiaire non déterminant, si possible remplaçable.
La production fascinante joue ici un rôle capital. Ce sont les biens issus de cette production qui sont les véritables acteurs : ils attirent, ils parlent d’eux-mêmes, ils séduisent… Quant à la production basique et nécessaire, pourquoi s’embarrasser de vecteurs humains, alors que leur demande est inéluctable, captive en quelque sorte ? La grande distribution a par exemple inventé le « drive » pour l’achat rapide et sans contact humain des biens basiques de la vie courante. Offreurs comme demandeurs y voient une manière d’éviter une perte de temps, qui semble au premier abord avoir plus de valeur que le contact humain.
Ainsi l’échange humain et qualitatif s’est éloigné, autant dans les flux de biens et services fascinants, que dans celui des biens primaires. Il s’est aussi éloigné dans le domaine des biens et services « collectifs », comme la santé, l’éducation ou l’énergie, que l’État ou les grandes entreprises étaient censés livrer à un public captif.
Dans plusieurs secteurs, les choses commencent cependant à changer, surtout parce que la production s’est trouvée confrontée à deux types de contraintes majeures : la rapidité de l’émergence des surabondances (même dans ce qui est innovant et fascinant) et la réduction de l’efficacité dans le gigantisme. Mais la rencontre effective des acteurs reste encore balbutiante, car elle se heurte à un second type de considération : la crainte (ou l’enfer…) liée à l’autre.
Le fait que l’on ait caressé le rêve du bien qui parlerait de lui-même et se vendrait « tout seul » avait aussi pour immense avantage la faculté de protéger du contact à l’autre pôle de l’échange, d’éviter de se frotter à lui et de subir les risques liés aux écarts et différences de tous ordres entre offreurs et demandeurs.
Contrainte par ces deux types de forces, la rencontre entre les acteurs se trouve repoussée, du moins tant que le contexte permet de s’y soustraire.
Il faut donc de sacrés trublions, ou de désastreuses conditions, pour que change la donne. Uber a forcé une bonne partie des taxis traditionnels à un effort de rencontre inédit avec les clients : des dialogues, des attitudes, des comportements beaucoup plus ouverts, affables et surtout adaptés à l’individu transporté…Et bien sûr un prix plus faible et plus juste. Les enquêtes de satisfaction expriment une différence très nette de comportement des taxis traditionnels depuis l’entrée en lice des « barbares »…
Au-delà du prix du billet d’avion, Easyjet tente d’insuffler une ambiance humaine à l’intérieur des avions, qui tranche avec celle des concurrents. Le personnel de bord cherche à installer un dialogue chaleureux et humoristique avec les clients, et de détendre une atmosphère qu’on dit parfois tendue à cette altitude… Les réactions sont parfois indifférentes ou négatives, mais majoritairement favorables, particulièrement chez les jeunes, qui représentent la majorité des clients.
L’ambiance n’est évidemment pas la même dans les banques, mais les nouveaux entrants du secteur bancaire ont aussi poussé les acteurs traditionnels à une volonté affichée de rencontre… qui reste à confirmer, et qui n’entame pas pour l’heure la conviction des grandes banques de détenir le pouvoir déterminant.
Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, l’a exprimé de façon intéressante. Il ne croit pas à l’« ubérisation » des banques, mais il voit le numérique comme une « formidable opportunité pour réinventer, intensifier la relation avec nos clients ». Curieusement, et avec une franchise louable, il reconnaît que la relation que le client pouvait nouer dans les agences n’était pas satisfaisante. Le maillage d’agences doit donc être réduit (de 20 % à horizon de 5 ans), et de ce fait, le canal numérique et le mobile deviennent les premiers points d’entrée : « Nous devons être capables d’offrir la relation en temps réel et personnalisée que permettent les nouvelles technologies »… Est-ce à nouveau faire la part trop belle au pouvoir de la technologie, ou une sorte de fuite devant les exigences du face à face 100 % humain ?
En tout cas, la richesse d’une rencontre client/fournisseur à travers l’outil numérique reste encore à inventer. Et Frédéric Oudéa de conclure : « C’est la qualité d’exécution dans le couplage de l’humain et du digital qui sera le facteur de différenciation déterminant ». Bel enjeu ! D’autant que le directeur général n’omet pas de rappeler que les « institutions » telles que la sienne ont des rôles bien supérieurs à ceux des nouveaux entrants agressifs ; il cite le financement de l’économie globale, la collecte de l’épargne, la taille impressionnante des bilans des grandes banques, et pense que l’avenir des nouveaux entrants, compte tenu des créneaux qu’ils visent, est loin d’être garanti dans la durée.
De façon plus péremptoire, Kyril Courboin, président de JP Morgan France, met en avant le poids des banques comme facteur déterminant de leur activité économique. La force prime largement sur tout argument d’action en finesse de tel ou tel acteur financier. À travers le prisme de la taille et de la puissance, il développait dans un entretien au « Figaro » de septembre 2015, un discours qui fait la part belle et exclusive à la production gigantesque de services, et qui ne dit à aucun moment quoi que ce soit sur l’échange… Sauf sur les « très grands clients ». Quelques extraits : « JP Morgan, avec 2500 milliards de taille de bilan, représente 13 % du PIB américain… L’Europe a besoin de grandes banques, capables de servir les très grands clients, les très grandes entreprises de la zone. Certaines banques américaines, dont JP Morgan, sont effectivement avantagées par leur taille pour appuyer les grands groupes européens »…
Qu’en est-il de la qualité de l’échange entre ces banques et ces grands groupes ? Pas un mot sur la question.
Kyril Courboin poursuivait : « Il existe en effet un débat sur le “too big to fail”, mais les régulateurs l’ont largement traité par des mesures qui imposent aux banques beaucoup plus de capital… Et puis il y a le débat sur le “too big to manage” ; des réponses sont apportées par les investissements massifs qui ont été faits dans les systèmes, les procédures, les équipes de contrôle interne, de conformité… » Priorité est donc donnée aux mesures de régulation qui s’imposent aux acteurs, mais qui n’en appellent ni à leur volonté propre ni à des schémas d’échange innovants. Les solutions appartiennent à la loi, à la règle, à la puissance, à la taille, aux process de production… On est sur une autre dimension qui semble pouvoir se passer des ressorts humains.
Pourtant, le président de JP Morgan France rappellait que dans les 20 prochaines années les dépenses mondiales d’infrastructures sont estimées à 57 000 milliards de dollars… Et qu’en dépit de leur taille, les banques ne pourront financer seules une telle masse. Il faudra alors mobiliser l’épargne des fonds de pension, des contrats d’assurance…, solliciter davantage d’acteurs, autant les grands que les petits.
Pourra-t-on alors continuer à se passer de la rencontre réelle entre ces acteurs, de genre, de taille et de culture différents ? Et auront-ils la volonté de progresser dans leur connaissance mutuelle ?
La connaissance progressive des acteurs
Faut-il mieux se connaître pour mieux échanger ? Répondre par l’affirmative semble tomber sous le sens. Ce ne fut pourtant pas le cas dans les sociétés industrielles et de consommation que nous avons connues. Durant des décennies, les rapports d’échange entre offreurs et demandeurs ont été marqués par la superficialité. Toujours à la chasse des coûts qui semblaient inutiles, on a surtout cherché à massifier et globaliser les populations d’acheteurs et les segments de marché, pensant ainsi identifier les produits et services qui convenaient aux uns et aux autres, sans avoir besoin d’une connaissance plus fine. Mais là aussi il semble que nous ayons atteint les limites des prouesses marketing antérieures.
La situation actuelle, qui produit les discours que l’on sait sur la « personnalisation » de la relation client, hésite entre la manipulation subtile (à partir de la collecte des données personnelles) et la recherche « honnête » des moyens de progresser dans la connaissance réelle des acteurs.
Laissons de côté la multitude des pratiques manipulatoires ; elles sont peut-être une nécessaire maladie infantile du passage d’une société mutique à une ère de « communication », se réduisant à une circulation incontrôlée et à sens unique d’informations. Il reste que ce foisonnement informationnel trompeur pose au regard de l’échange un problème majeur : l’installation d’une méfiance aiguë qui pousse nombre d’acteurs à l’incrédulité et à la fermeture. Le rejet de sources d’informations et de connaissance qui pourraient réellement être utiles fait que la mauvaise monnaie d’échange chasse la bonne…
Mais cette contrainte, dont l’effet bloquant est patent, ne doit cependant pas nous empêcher de porter notre regard sur des situations plus constructives. Quand ils ont une volonté réelle de mieux se connaître, offreurs et demandeurs passent de la simple rencontre à un dialogue maintenu dans le temps et au partage d’expériences communes sur les produits et services.
De nombreuses entreprises ont tenté d’initier « honnêtement » ce dialogue, en allant à la rencontre du client, et en cherchant à travers l’écrit et le numérique à engager et garder le contact avec lui. Leurs efforts sont payants lorsque la démarche est persévérante, et ne cherche pas à masquer les points d’écart, voire de désaccord. Le succès est d’autant plus affirmé quand l’entreprise et ses clients vivent des moments de partage objectif portant sur les qualités et défauts des biens achetés ou achetables. La mutuelle d’assurance MAIF a par exemple depuis longtemps et au fur et à mesure de son ouverture à de nouvelles populations d’assurés, entrepris et soutenu une démarche en ce sens.
Quand les opérations « portes ouvertes » offrent un vrai dialogue et un partage fertile, elles montrent tout sans maquillage… Pour que les tests de résistance, de qualité ou de conformité fassent progresser la connaissance mutuelle, ils doivent prendre le risque de l’imperfection, voire de l’échec. Les opérations de relations publiques trompeuses se payent très durement le moment venu. La facture est lourde financièrement, et plus encore relationnellement. Citons l’exemple de Volkswagen, incapable de maîtriser et de dissimuler durablement une tromperie sur le diesel. Couverte par l’image de sa production à la fois fascinante et sécurisante, socle d’une gigantesque puissance de (non-)échange, la firme n’a pas subi de chute notable de ses ventes; inutile de se remettre profondément en cause dans ces conditions.
Au fond, le monde économique classique agit selon sa rationalité habituelle et ses réflexes acquis. La transparence a non seulement un coût, mais comporte des risques. Des risques d’image et de dévoilement défavorables, qui n’apparaissaient pas spontanément dans la connaissance superficielle. La firme Volkswagen aurait-elle pu imaginer que les risques du non-dévoilement pouvaient s’avérer beaucoup plus graves ?
Elle s’est au contraire laissée aller sur la pente commune. Si les produits et les services se vendent, pourquoi chercher à progresser dans la transparence et la connaissance entre acteurs ? Tant que le business fonctionne, laissons faire, laissons passer !… Et restons pragmatiques : dans le cas de Volkswagen comme dans la plupart des cas, une connaissance plus profonde du client se justifie seulement si les produits ou services risquent de se vendre moins bien. Quant à la transparence, elle ne vient qu’en réaction à une situation de crise.
Or l’échange prend toute sa signification quand la démarche de l’entreprise pour en savoir davantage sur le client se conjugue avec la possibilité pour ce dernier d’en savoir davantage sur l’entreprise… Et pas seulement pour découvrir et utiliser les vices ou les failles de l’autre !
Pour l’instant, et peut-être en raison de leur « jeunesse », Uber et les autres évitent les travers des voies classiques. Leur exposition médiatique les oblige à une transparence forte, qui est aussi une opportunité à saisir. Les nouveaux entrants transgressifs ont, à leur stade de développement, tout intérêt à favoriser un approfondissement de la connaissance avec leurs clients actuels et potentiels, grâce à leur maîtrise des moyens numériques. D’abord pour affiner et perfectionner leur offre présente, et aussi parce que c’est avec eux qu’ils écriront un futur peut-être très différent de ce qu’ils vivent aujourd’hui.
Des négociations loyales
Des échanges équilibrés ?
L’échange n’est jamais parfaitement équilibré. Ce ne serait d’ailleurs pas une bonne chose, car pour maintenir cet équilibre parfait en tout point et en toute circonstance, les acteurs s’observeraient de façon tatillonne, se perdraient en considérations mesquines, et finalement en feraient le moins possible. Pour maintenir l’équilibre parfait le mieux est de ne rien bouger, ne rien changer… Autant dire s’extraire de l’activité économique.
Pour autant, l’échange ne saurait être exagérément et durablement déséquilibré au détriment de l’un des acteurs. Les économistes ont depuis longtemps inventé à juste titre le terme de « détérioration des termes de l’échange » pour désigner cette situation. On peut l’observer dans n’importe quel type d’échange (pas seulement entre pays riches et pays pauvres), mais la voie praticable et raisonnable n’est pas la recherche de l’équilibre ; c’est de parvenir, selon les situations et les circonstances, à un échange alternativement déséquilibré.
En clair, si un acteur a fortement gagné durant une période dans l’échange avec son ou ses partenaires, il doit accepter de redonner ou remettre en jeu une partie de ses gains… pour que le jeu continue. Mieux vaut un moindre avantage dans un jeu poursuivi, que plus de jeu du tout… Car si d’aventure le jeu s’arrête, ce sont les plus avantagés qui ont le plus à perdre ! Ainsi, l’entreprise, le client ou le partenaire, quels qu’ils soient, se retrouvent sur le même axe : celui qui a profité de prix ou d’avantages exceptionnels, ne saurait les considérer comme un acquis et se comporter comme si tout devait continuer à suivre la même pente.
Utopique et irréaliste ? Parfois. Mais c’est pourtant ce qu’on observe, avec retard et ressentiment, dans de nombreuses situations : les remises de dette à grande comme à petite échelle, les coopérations surprenantes entre acteurs favorisés et défavorisés, entre les flamboyants gagnants de l’économie numérique et les espaces de sous-développement, entre les richissimes pays pétroliers et les « vieux » pays européens… Cela dit, celles de ces situations qui ont une probabilité de durer donnent bien lieu à des échanges alternativement déséquilibrés : débiteurs finissant par honorer leur dette, avantages induits pour les donateurs, richesses immatérielles contre richesses matérielles…
Pour en arriver là, chacun mesure l’effort à produire et la révolution à opérer dans la plupart des secteurs. Mais faire que la réalité de ces échanges puisse s’inscrire de façon plus courante dans les situations quotidiennes nécessite un facteur dans les négociations « loyales » : la transgression des barrières liées à la taille et au statut.
Une négociation à armes égales avec les entreprises transgressives et conquérantes?
Peut-on négocier avec Uber et les autres ? Dans la phase actuelle de leur montée en puissance, la chose reste difficile. C’est en tout cas ce que prétendent les fédérations de l’hôtellerie, de taxis, les mairies de toutes les grandes villes attirantes et « branchées », à l’égard d’Uber et de Airbnb par exemple. Et c’est aussi la position de simples chauffeurs, qui ont cru en Uber. Ils affirment et clament haut et fort que les règles du jeu ne sont pas respectées par les nouveaux entrants, qui imposent leurs diktats et ne respectent ni l’égalité devant les charges, ni la concurrence loyale…
Dans les conditions actuelles de forte tension, l’hypothèse de négociations s’éloigne ; et pour les adversaires des nouveaux entrants, c’est l’urgence de nouvelles réglementations qui s’impose. Le mouvement enfle de New York à Barcelone, de Paris à San Francisco… Dans cette dernière ville, on a été jusqu’à organiser un référendum pour brider l’action et l’extension de Airbnb, en tentant d’imposer une stricte limitation des locations de courte durée, qui sont le coeur de l’activité de l’entreprise. La proposition (appelée « proposition F ») a été rejetée à une forte majorité. Preuve de l’attachement du plus grand nombre à l’ouverture créée par Airbnb, et de la difficulté d’initier une vraie négociation loyale avec les entrants conquérants.
Il reste que les revendications des protestataires sont ambigües. D’un côté, elles concernent la possibilité d’exercer leur activité à armes égales avec les nouveaux entrants ; ce qui est évidemment d’une importance majeure pour les négociations qu’ils peuvent mener avec leurs propres clients ou usagers historiques. Mais d’un autre côté, elles ne peuvent échapper au soupçon de vouloir maintenir en l’état la situation antérieure, avec les habitudes, les avantages acquis, et… l’absence d’échange réel et profond qu’elle perpétuait. Ce qu’une part importante du public semble maintenant définitivement rejeter.
On pourrait en induire que, malgré les tensions et blocages actuels, les acteurs installés ne pourront plus à l’avenir reproduire à l’identique les comportements passés de fermeture à l’échange. L’ouverture créée par l’intrusion des nouveaux paraît irréductible.
C’est probablement l’une des raisons majeures qui pousse les Uber, Blablacar et Airbnb à réagir à la vague contestataire de façon plutôt modérée et conciliante. Leur ligne de défense abonde dans le sens d’une compétition à armes égales et de perspectives du type « gagnant-gagnant ». Airbnb l’exprime ainsi : « Nous ne volons pas de parts du gâteau ; nous faisons grossir le gâteau »…
La négociation à armes égales grâce aux nouveaux entrants
Peut-on négocier avec des mastodontes ? Peut-on négocier alors que les prix sont imposés ? On aurait envie spontanément de répondre « non », mais les acteurs qui ont essayé n’ont pas tous échoué. Uber et les autres ont introduit l’agilité, la mobilité, la légèreté, la rapidité, au cœur du terrain économique et de son efficacité. Les grands acteurs installés nourrissent tous, malgré leur puissance, un réel complexe face à ces caractères qui leur sont chaque jour un peu plus étrangers.
Du coup, la grande entreprise qui négocie avec un trublion agile, ou avec un acteur individuel original, ne le fait plus nécessairement dans un rapport de dupes ou de soumission. Une telle perspective représente maintenant pour l’acteur puissant une bouffée d’oxygène, voire un aiguillon salutaire.
Évidemment les vieux réflexes reptiliens ont toutes les chances de réapparaître, mais l’intrusion des « barbares » a créé une ambiance nouvelle. Du coup, il devient permis de saisir l’opportunité d’une négociation féconde, autant avec son voisin de palier qu’avec un grand groupe ! Les discussions qui en résultent se font de façon tout à fait décomplexée, avec le sentiment de combler un vide ou un manque, et dans la plupart des cas d’agir dans l’intérêt commun.
On assiste à une véritable libération des négociations à « armes égales ». Elles concernent le logement, le déplacement, les connaissances (« moocs »), l’argent (« crowdfunding »), la production de biens à petite échelle (entre particuliers ou en petits groupes) et progressivement à grande échelle (coopérations déverrouillées entre apporteurs de compétences et grandes entreprises).
L’économie classique nous a habitués à une déconnexion totale entre l’univers de la négociation et celui de la solidarité, mais il est temps de revoir la question. La libération du champ de la négociation entre acteurs économiques offre des perspectives neuves, et renvoie à la conscience et à l’élargissement de solidarités très engageantes pour nombre d’acteurs actuels et potentiels.
La conscience et la construction de solidarités profondes
Les acteurs (offreurs et demandeurs) qui assurent le succès des entreprises transgressives font entrer dans le champ économique des préoccupations, des valeurs et des idéaux qui se situent au-delà des actes de production et d’échange au sens strict.

Écoutons sur ce point la réponse de Frédéric Mazzella, président fondateur de BlaBlaCar, à la question du « Figaro Entreprises » du 7/8 novembre 2015 : « Quel est l’impact de l’économie du partage sur notre société ? D’abord, elle rapproche les gens, car pour partager, il faut être proche. Cette économie permet de plus grandes connexions sociales, plus de respect, de considération entre les individus. Elle tend aussi à modifier les rapports entre les générations. Ce sont les jeunes qui désormais apprennent aux plus anciens comment fonctionnent ces nouveaux services. Quel changement ! »
La qualité de la relation devient donc une préoccupation majeure. Et ce sont deux grands types de relation qui vont concentrer les solidarités. Comme on vient de le voir dans la réponse de Frédéric Mazzella, la relation de solidarité entre les êtres est capitale dans le fonctionnement de ce qu’il nomme l’« économie du partage ». Mais dans le même temps, on assiste à la constitution d’un autre tissu relationnel majeur : celui qui concerne la relation de solidarité entre les acteurs et leur environnement.
La proximité entre offreurs et demandeurs présentée comme une condition impérative tranche avec le postulat de l’économie classique qui considère la proximité comme une entrave à la concurrence. De la même façon, le « respect » tel que le voit l’économie classique est plutôt synonyme de distance nécessaire entre les acteurs ; quant à la « confiance », elle est invoquée de façon abstraite comme une atmosphère globale, une attitude grégaire qui disparaît et revient, au gré des conditions ambiantes ou du génie des « magiciens » de l’action publique… Mais elle n’est pas vue comme la construction persévérante d’un vrai bien immatériel, ayant une valeur en lui-même (et non pas dans sa valorisation exclusive par l’économie matérielle).
Or le fonctionnement de l’économie relationnelle (terme qui est ici préféré à celui d’« économie du partage ») redonne au respect sa signification véritable et érige la confiance en ingrédient impératif des transactions. C’est grâce à la confiance ayant une valeur en elle-même qu’on peut envisager la multiplication de situations impensables dans l’histoire classique : des individus et des entreprises mettant à disposition d’autres acteurs leurs biens et leurs ressources, des voitures, des logements, des informations, des connaissances… échappant à l’emprise individuelle, en transgressant le frein de la méfiance et du droit de propriété.
La solidarité entre les acteurs qui, répétons-le, n’est pas contraire à la négociation mais chemine avec elle, se manifeste à plusieurs niveaux : entre ceux qui ont et ceux qui manquent, entre ceux dont les compétences ou les ressources se complètent, entre ceux qui savent et ceux qui ignorent, entre les générations, et peu à peu entre les entreprises transgressives et les pouvoirs publics… quand ces derniers sont capables de donner priorité à l’efficacité et à l’optimisation des ressources existantes.
Et le mouvement de fond est d’autant plus fort, qu’il est stimulé par la conscience et les progrès d’un autre type de relation : celle qui se développe entre les acteurs et leur environnement. Cette relation est davantage qu’un appui ; c’est un second moteur puissant qui anime de nouveaux schémas économiques.
La lutte contre le gaspillage des ressources et contre la pollution, la conscience des enjeux écologiques et des impacts environnementaux deviennent aussi des facteurs incontournables de solidarité entre les acteurs. Dans l’entretien cité plus haut, Frédéric Mazzella rappelle que « les voitures passent 96 % de leur temps arrêtées, 0,5 % dans les bouchons, 0,8 % à tenter de se garer… Reste 2,7 % de temps d’utilisation, avec une seule personne à bord durant les ¾ de ce temps d’utilisation… Soit finalement une utilisation réelle de 0,7 %, pour un bien qui pèse 10 % du PIB ! » Bel exemple de gaspillage et de pollutions induites, qu’un nombre croissant d’acteurs a de plus en plus de mal à accepter.
Dès lors, si dans un tel contexte, une entreprise transgressive parvient à mettre au point un système de covoiturage attirant et convaincant (sans réclamer de subvention !), il est logique de voir des millions d’acteurs en saluer solidairement la pertinence et en amplifier la performance.
Ainsi, le rejet des postulats et des pratiques de l’économie classique, la lutte contre le cynisme des relations de connivence, la montée des préoccupations environnementales et la libération des verrouillages de l’échange libre, restent à notre sens les moteurs déterminants de l’attraction des nouveaux champs de l’économie relationnelle et de l’adhésion intuitive ou raisonnée de nombre de ses acteurs et supporters.
Ubérisation ou BlaBlaCarisation ?
Les multiples ruisseaux de l’« ubérisation » contiennent incontestablement des espaces et des moments de progression de l’échange réel. Mais le tableau est loin d’être homogène. Les ruisseaux sont encore loin de se réunir en un véritable torrent ou a fortiori un tsunami propulsant l’échange vrai à sa juste place, à l’égal de la production matérielle.
Le terme d’« ubérisation » est un fourre-tout qui ne parvient plus à rendre compte de la diversité des trajectoires, des motivations et des valeurs des entreprises transgressives. Des différences profondes commencent à se marquer entre l’ubérisation à l’américaine, fondamentalement préoccupée de performance quantitative éblouissante, et d’accession au statut de « licorne », et une voie plus « européenne », davantage soucieuse d’échange réel et d’environnement. BlaBlaCar nous paraît être un bon représentant de cette seconde voie. Son fondateur a retenu de son parcours américain une leçon majeure de dynamisme entrepreneurial, où rien n’est a priori impossible, mais a laissé de côté les excès des critères matériels pour juger de la valeur d’une entreprise, de son potentiel et de son avenir.
C’est pourquoi, à côté du terme « ubérisation » qui désigne bien une réalité particulière, il nous semble urgent de mettre à l’honneur le terme de « blablacarisation » pour caractériser les entreprises transgressives, pour lesquels la réussite matérielle est plutôt une conséquence qu’un objectif tutélaire. Conséquence d’échanges approfondis, de confiance construite et constamment recréée, de solidarités entre les êtres et avec le milieu.
Nous avons suffisamment insisté sur le pouvoir de séduction de la production innovante, et sur l’aspect incontournable de la production basique pour expliquer l’oubli ou l’ignorance des efforts à déployer pour soutenir l’échange vrai. Nous avons aussi rappelé combien les exigences d’un tel échange autorisaient les réflexes de fuite ou de manipulation privilégiant les apparences d’échange, au détriment du fond.
Et nous n’avons pas non plus omis de remarquer que dans un monde obsédé par les progrès quantitatifs, la multiplication des quantités échangées tenait couramment lieu de « succès de l’échange »… L’« uberisation » comporte un danger sérieux du côté des demandeurs : le fait d’assimiler le terme simplement au « low cost ». Les clients et supporters des perturbateurs de l’économie traditionnelle, seraient-ils exclusivement mus par l’attractivité et la recherche d’un prix inférieur ? Et les entreprises transgressives n’auraient-elles pour seuls buts que le pouvoir et la fortune ?
Tout se joue finalement autour du terme « exclusivement », et la « blablacarisation » est de nature à nuancer fortement cette exclusivité. Ou bien le prix bas n’est qu’un élément parmi un faisceau de forces qui poussent vers la pratique de l’échange réel, et nous nous trouvons alors dans une véritable lame de fond renversant les acquis de l’économie classique ; ou bien le prix minimum est finalement le seul vrai déterminant, et nous avançons au contraire vers un approfondissement des voies classiques et du management des apparences.
Rien de nouveau sous le soleil voilé de « smog » ? Peut-être, mais l’économie de la relation est loin d’avoir exprimé son dernier souffle.
Notes
1 Pratique des tribus indiennes du Nord-Ouest américain, de Mélanésie et de Papouasie : l’obligation de donner, de recevoir, de continuer à donner davantage, et ainsi de suite… décrite par Marcel Mauss dans Essai sur le don, 1925. De notre point de vue, donner et recevoir, « don contre don », matériel ou immatériel, est déjà de l’échange.
2 Voir M. Obadia, Pour une économie de l’humain, Village Mondial, et Quelle économie voulons-nous ? Eyrolles.